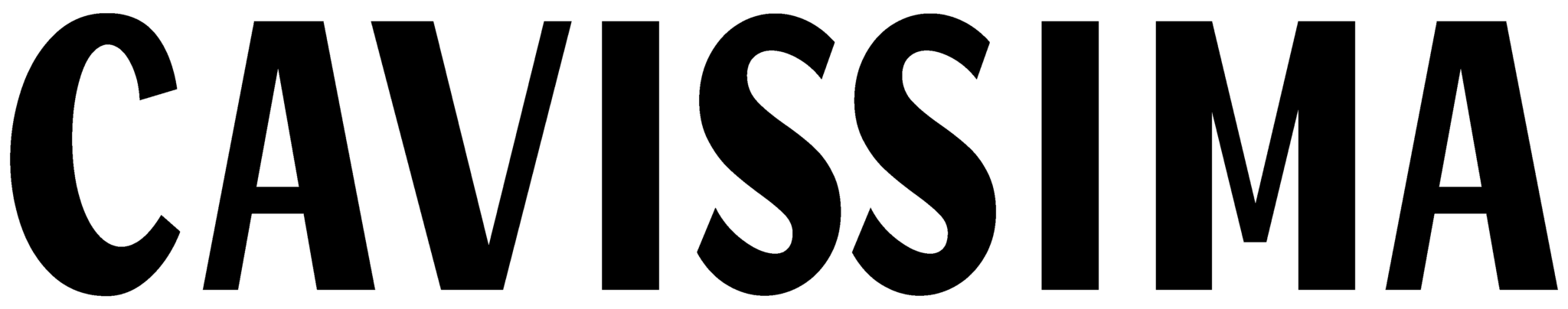Meilleur Ouvrier de France : entre tradition et diversité
Le concours du Meilleur Ouvrier de France est le fruit d’une grande tradition française pour la reconnaissance de l’artisanat et du savoir-faire. Originellement, se sont les Compagnons qui créèrent cette institution, mais au fil des années, la diversité des spécialités a ouvert le concours. Le premier diplôme a été remis en 1924 dans le cadre des Expositions du Travail. En 1927, René PETIT, menuisier ébéniste (MOF en 1927) fonde la société des « Meilleurs Ouvriers de France ». Celle-ci aura récompensé jusqu’à aujourd’hui environs 1800 ouvriers artisans, qui sont l’élite dans plus de 200 métiers.
Un concours ou l’excellence est de rigueur
Par ailleurs le musée national des Meilleurs Ouvriers de France a été créé en 1994 à Bourges, où les visiteurs peuvent admirer certaines des plus belles œuvres réalisées dans le cadre du concours.
L’objet de ce concours est d’une part de mettre en valeur le savoir-faire français. Au travers des exigences de ce concours, les candidats sont poussés à innover, à se renouveler et à exceller dans leur discipline.
Dans chaque épreuve les juges cherchent la perfection, le candidat dispose d’un temps donné et de matériaux de base pour réaliser un chef d’œuvre. La méthode choisie, l’organisation, le geste, la rapidité, le savoir-faire et le respect des règles du métier sont contrôlés par le jury autant que le résultat. Le candidat ainsi récompensé conserve son titre à vie avec l’indication de la spécialité suivi de l’année de sa promotion (l’année d’obtention).
D’autre part, c’est aussi un moyen de soutenir les activités artisanales puisque le titre permet d’augmenter le chiffre d’affaires de 30% en moyenne. Le titre prestigieux étant reconnu par les professionnels ainsi que par le grand public, les MOF bénéficient d’un rayonnement très large.
Par ailleurs l’obtention du titre de Meilleur Ouvrier de France, est équivalente à l’obtention d’un diplôme de niveau III (BTS).
Critères des épreuves de sommellerie
Les épreuves de sommellerie sont divisées en deux parties, la pratique et la théorie. Les critères sont notamment la pratique de l’anglais, l’accord mets et vin, le service des boissons et les commentaires lors de la dégustation. Pour la théorie il s’agit de maîtriser la carte des vins, la connaissance des vignobles, des techniques de vinification ou encore de l’aspect législatif. Les juges requièrent également une excellente connaissance de la culture gastronomique et de l’œnologie évidemment.